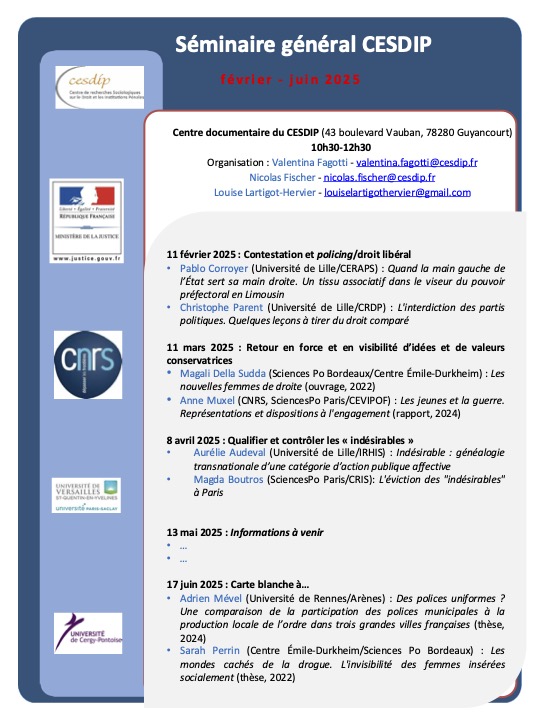Le CESDIP, longtemps dépourvu d’une tutelle universitaire, compte désormais en son sein un nombre appréciable de doctorants. Depuis 2009, nous obtenons plusieurs contrats doctoraux -au travers de l’École doctorale et également, par les contrats de la région Ile-de-France-. Ce qui a contribué à augmenter notre nombre de doctorants. Les doctorants sont totalement intégrés dans les thèmes que nous portons -de récentes thèses ont ainsi été engagées, autour des questions de bases de données judiciaires et sur les questions pénitentiaires-.
Outre le financement de la participation aux colloques et missions de recherche, le laboratoire a amélioré les conditions d’accueil de ses doctorants :
- Mise en place des comités de thèse pour chacun de nos doctorants. Ces comités sont composés de trois à quatre membres (en incluant le directeur de thèse) qui couvrent les différents thèmes traités dans la thèse. Ces comités se réunissent a minima 2 fois au cours de la thèse, mais ils peuvent l’être plus fréquemment en fonction des besoins.
- Depuis 2012, un séminaire des doctorants est mis en place. Les doctorants sont les organisateurs des séminaires du Cesdip ainsi que du séminaire général du CESDIP au cours de laquelle ils présentent leurs travaux en cours et discutent de problématiques de leurs recherches. À ces séances, interviennent ponctuellement des chercheurs du laboratoire pour éclairer une question particulière et parfois des intervenants extérieurs au laboratoire de recherches.
- Mise en place de deux universités d’été pluriannuelles et internationales, l’une dans le cadre du GERN (GERN Summer school, avec la possibilité de communiquer et de publier en anglais), l’autre dans le cadre d’un réseau d’université francophone autour d’enjeux de méthodologie des sciences sociales (Méthodologie de la recherche en sciences humaines et sociales avec l’Université Catholique de Louvain, l’Université de Liège et l’Université du Québec à Montréal).
Sur ce tremplin, le CESDIP continue de parfaire la formation de ses doctorants, en accentuant la dimension internationale de leurs parcours (formation en langue, séjours à l’étranger, co-tutelles et co-financements internationaux).
Thèse en sociologie, de Camille Chopart Cette thèse sera l’occasion de se demander comment les aménagements de peines sont donnés selon le genre, qui obtient des aménagements de peine, est-ce que leur genre a de l’importance dans cette obtention ? On aura comme objectif de comprendre comment est prise la décision d’accorder un aménagement de peine aux justiciables ; comment cette décision est prise par les magistrat.es lors de l’audience et de la condamnation mais également au sein de la prison lors des commissions d’application des peines. Cette thèse nous conduira à interroger les liens entre prison et aménagement des peines, il faudra se demander quel est le sens de la peine quand elle est exécutée en dehors de la prison. Enfin, le vécu de l’aménagement est-il similaire selon le genre des justiciables : les possibilités sont-elles les mêmes pour tous les individus (le type de travail d’intérêt général proposé, etc.) ? Qu’en est-il du corps des condamné.es ? Est-ce similaire entre hommes et femmes ? Comment la personne condamnée appréhende-t-elle la peine en milieu ouvert ? Thèse en sociologie, de Dimitri Coste Le maintien de l’ordre connaît un processus de judiciarisation croissant. La thèse vise à comprendre 1) comment les dispositifs (législatifs, administratifs, policiers, judiciaires) préalables aux manifestations opèrent une gestion préventive des illégalismes protestataires, 2) comment s’articulent la mission administrative de gestion de l’ordre public et la poursuite pénale et 3) comment les acteurs de la chaîne pénale répondent en pratique à la massification des flux de manifestants poursuivis. Des éléments d’histoire du droit et de sociologie quantitative de l’activité judiciaire seront complétés par une partie ethnographique, qui prendra la forme d’une étude des conditions pratiques de traitement des dossiers par les officiers de police judiciaire, procureurs et juges. Thèse en sociologie, de Thibaut Daussy Cette étude porte sur la mise en œuvre locale de la politique de « lutte contre la radicalisation violente » au sein de l’administration pénitentiaire. Il s’agit plus précisément de questionner l’impact de cette politique sur l’organisation carcérale. Ce travail s’inspire des recherches en politique publique, des travaux sur l’engagement/désengagement militant et de la sociologie des institutions afin de saisir l’action publique par le bas à travers sa mise en œuvre par les professionnel.les et sa réception par le public ciblé. Cette recherche repose sur une approche ethnographique à travers une immersion au sein de différents établissements et services pénitentiaires attachés à une direction interrégionale. Outre un travail d’observation et de suivi des équipes, des entretiens sont réalisés avec l’ensemble des acteur.trices impliqué.es dans cette politique. Thèse en science politique, de Adrien Maret. Cette thèse propose une analyse transversale prenant en compte à la fois les politiques publiques dans le milieu prison/justice, les relations institutionnelles entre les pouvoirs publics et les associations et enfin l’activité des acteurs de terrain. Cette étude s’intéresse aux nombreuses pistes de recherche non explorées concernant la prise en charge des personnes majeures. Elle questionne l’impact de la régulation par l’État des interventions associatives dans le domaine carcéral et socio-judiciaire. Ainsi, l’état des lieux établi du monde associatif prison/justice est mis en perspective à partir de deux axes principaux d’analyse. Premièrement, les reconfigurations de l’action publique depuis les années 1980 sont étudiées dans le domaine spécifique de l’application des peines, à partir de la relation à des acteurs périphériques, les associations. L’étude des transformations du secteur de la pénalité, régalien s’il en est, permet un va-et-vient analytique : étudier les conséquences concrètes sur la prison comme sur les associations de la rationalisation des dépenses publiques et de l’ouverture au secteur marchand tout en permettant, à partir de ce cas précis, un éclairage plus général sur le fonctionnement de l’État. Deuxièmement, le fonctionnement des associations est analysé au prisme des relations que celles-ci entretiennent avec l’administration pénitentiaire, témoignant ainsi de l’évolution des politiques carcérales et pénales. D’une part, cela questionne les ambiguïtés du processus majeur d’« ouverture » que connait la prison depuis les années 1970, symbolisé à plus d’un titre par les intervenants extérieurs, notamment associatifs. D’autre part, le secteur associatif est de plus en plus confronté aux injonctions étatiques liées aux politiques sécuritaires de la « gestion des risques » et de la « prévention de la récidive ». Thèse en sociologie,de Baptiste Mollard La gestion et l’encadrement de l’émigration des travailleurs algériens ont fait l’objet à partir de l’insurrection de novembre 1954 d’un investissement administratif sans précédent dans l’histoire de l’action publique coloniale et impériale en Algérie. Plusieurs projets de sélection sociale de l’émigration sont ébauchés, présentés comme étant à la pointe du progrès social (ou de la contre insurrection) en Algérie française. Il n’y a pourtant que très rarement eu de contrôles autres que policiers et militaires sur les émigrés pendant ces années de guerre. À partir de l’Indépendance, ces dispositifs d’encadrement ont été repris en les nationalisant par l’élite politique et administrative du nouvel État algérien, dans l’espace de manœuvre souvent étroit laissé par la coopération avec l’État français. Considérant cette transition non-linéaire d’une émigration coloniale à une émigration encadrée par l’État algérien, l’étude de la séquence entre 1955 et 1974, depuis la genèse de ces projets d’encadrement jusqu’à la suspension officielle de l’émigration vers l’Europe par le président Houari Boumediène, permet de rattacher le phénomène aux processus de formation d’un État algérien. Thèse en sociologie, de Shaïn Morisse L’abolitionnisme pénal, apparu dans les années 1960 en Europe et en Amérique du Nord, renvoie à des développements théoriques, des luttes et des pratiques extrêmement hétérogènes dans le temps et l’espace, poursuivant des objectifs multiples et des logiques complexes. Il constitue à la fois une forme de mobilisation collective directement engagée dans la résistance et la contestation des logiques, des politiques et des pratiques pénales ; un projet intellectuel porteur d’une perspective théorique spécifique et une vision du monde particulière ; et un arsenal cohérent de valeurs éthiques et politiques alternatives, couplé à un répertoire d’expériences et de pratiques, destinés à façonner et réguler la vie en société. Notre projet de thèse se propose d’étudier l’abolitionnisme pénal européen d’un point de vue empirique et systémique, comme un mouvement social transnational, depuis son origine jusqu’à nos jours, et dans toutes ses composantes (académique et militante, théorique et pratique, politique et éthique). Thèse en sociologie, de Pierre Pozzi Cette thèse propose d’étudier les processus sociaux qui informent les relations entre les collégien.ne.s et lycéen.ne.s et les forces de l’ordre. Elle questionne la manière dont les jeunes se socialisent à la police et les mécanismes d’intériorisation de l’autorité de l’Etat et de ses représentant.e.s. En produisant des connaissances empiriques et théoriques sur la genèse des rapports entre les jeunes et les policier.e.s, nous tenterons de contribuer à une meilleure compréhension des rapports police-population en général, ainsi qu’à une réflexion plus large sur les processus de fabrication du consentement à l’ordre social. Thèse en sociologie, de Aurélien Restelli Dans les pays occidentaux, on assiste à une logique de pluralisation des activités policières. Cela touche notamment le domaine de la police des foules ; en effet, de plus en plus d’unités, dont l’organisation et les modes de fonctionnement peuvent parfois être très différents, sont amenées à participer aux opérations de maintien de l’ordre. La question se pose donc de savoir comment, aussi bien en bas de la hiérarchie qu’au niveau de l’état-major, elles échangent, se jugent et se coordonnent pour mener à bien les opérations de maintien de l’ordre Thèse en sociologie, de Marguerite Trabut Thèse en sociologie, de Chloé Lala-Guyard
6 octobre 2022 – Thèse en sociologie, de Rita Carlos. Suivant un double regard, socio-historique et monographique, cette thèse analyse les processus de catégorisation des mineurs enfermés que (re)produisent les professionnels de justice, depuis deux siècles, en France. L’étude des mécanismes de racialisation des justiciables, notamment avec l’emploi des théories de la dégénérescence, sera l’occasion d’interroger les effets des (di)visions raciales sur le développement de la chaîne pénale et les trajectoires différenciées des jeunes, dans et entre les dispositifs, aujourd’hui comme hier. Dans une première partie d’ordre socio-historique, cette recherche met en lumière les classifications des mineurs dits « sous main de justice » fondées sur la race qui émanent de l’histoire de leur enfermement, autant qu’elles en structurent l’évolution. Le rôle prépondérant joué par les assignations racialisantes dans la justification de l’extension et du durcissement de la chaîne pénale invite à considérer leur imbrication avec d’autres rapports sociaux basés sur l’âge, la classe, le genre, la sexualité, la nationalité, la religion, le territoire de résidence et la santé, qu’elle soit physique et/ou mentale. Il s’agit ainsi de saisir les soubassements de la diffraction qui s’opère, depuis le XIXe siècle, entre les éléments assimilables au corps national et les éléments qualifiés de pathogènes, dont il faut éviter la contamination et la prolifération, au nom de la préservation physique et morale des êtres sains, dans les espaces publics puis éducatifs. À partir d’une réflexion sur ces logiques prophylactiques, justifiées par des savoirs scientifiques au service d’objectifs politiques, je propose un regard sur la genèse et l’actualité des lieux d’enfermement pour mineurs, voulus comme porteurs et symboles de progrès, tandis que leurs échecs récurrents demeurent attribués à la sauvagerie d’une partie de leur public, laquelle légitime en retour l’usage de techniques disciplinaires désuètes.Une seconde partie d’ordre monographique, à partir d’une immersion en Centre éducatif fermé (CEF), jour et nuit, sonde l’impact de l’intervention quotidienne des acteurs de justice sur les carrières disciplinaires des jeunes au prisme des choix de recrutement, de la division du travail, du tri des mineurs et des pratiques d’encadrement différenciées. En combinant observations, analyses documentaires et entretiens semi-directifs menés avec les adolescents placés, les éducateurs et les cadres, cette enquête interroge les catégories territoraciales qui conditionnent les représentations, les pratiques et les positions des personnels en CEF. Cette approche par les expériences des publics visés est l’occasion d’examiner le lien entre les assignations territoriales qui euphémisent la racialisation, et l’action territoriale à l’encontre des mineurs menaçants qui aboutit au regroupement, à la mise à l’écart voire au renvoi des justiciables racisés de l’établissement vers la prison. Le point d’entrée par les classifications des professionnels prend d’autant plus de sens qu’il éclaire la limitation des marges de manœuvre des reclus, enjoints individuellement à être acteurs de leur réussite tout en étant constamment associés à des groupes porteurs de stigmates, bénéficiant plus ou moins de l’économie relationnelle et émotionnelle à l’œuvre dans le CEF, autrement dit de circonstances aggravantes ou atténuantes dans leur évaluation. L’ambiguïté du dispositif, entre discipline et auto-contrôle, est pensée au prisme de la lutte des places que se livrent les mineurs dans l’établissement et de ses conséquences sur leur parcours institutionnel au-delà de celui-ci.Ce dispositif méthodologique double permet in fine d’interroger les reconfigurations de la chaîne carcérale et de ses hiérarchies correctionnelles au regard des publics visés, tout en accédant, par le terrain, à la contrainte multidimensionnelle que subissent les reclus, à savoir une mobilité disciplinée qui est non seulement physique mais aussi sociale et symbolique. 30 mars 2022 – Thèse en sociologie, de Tiffen Le Gall. Comment expliquer et tenter d’endiguer la dérive de ces enfants, nés en France, qui se radicalisent et tombent dans la violence politique et religieuse, vis-à-vis de leur pays ou d’eux-mêmes, au nom d’un idéal opposé aux valeurs de la société occidentale ? La problématique centrale de la recherche, qui sera consacrée à la radicalisation des mineurs et à la répression de ce phénomène, se déclinera en deux volets complémentaires, sociologique et juridique. Nous analyserons dans un premier temps les carrières biographiques de mineurs radicalisés, afin de comprendre le cheminement processuel qui mène à l’adhésion à une idéologie radicale violente, pouvant aller jusqu’à un départ vers une zone de conflit, voire une tentative d’attentat, parfois kamikaze. Dans un second temps, nous étudierons les politiques pénales et les dispositifs de prise en charge (dits de « déradicalisation ») et de sanction qui s’appliquent à ces personnes. Nous nous intéresserons ici particulièrement aux effets de ces politiques publiques réparatrices ou répressives sur la radicalisation des individus. L’étude se concentrera sur les mineurs, et jeunes adultes qui peuvent bénéficier, jusqu’à l’âge de vingt et un ans, du régime dérogatoire protecteur accordé aux mineurs par l’ordonnance du 2 février 1945. Si l’étude sera principalement centrée sur le cas français, nous intégrerons une dimension comparative avec d’autres modèles juridiques, ou administratifs et sociétaux, notamment ceux en vigueur dans certains Etats membres de l’Union européenne, avec pour objectif d’analyser les dispositifs de lutte contre la radicalisation mis en place dans ces pays et de les comparer au cas français. Enfin, si l’étude est limitée aux mineurs qui se radicalisent au sein du groupe Daesh, nous établirons quelques comparaisons avec d’autres groupes terroristes, notamment Al Qaeda. L’étude impliquera un travail préliminaire de définition du terme « radicalisation ». Ce phénomène nous apparaît a priori davantage comme l’aboutissement d’un processus plus ou moins long, faisant intervenir différents facteurs, que comme un simple basculement. Nous procèderons ensuite à l’analyse de ce processus ; les étapes, les facteurs , et les effets produits, en s’intéressant notamment aux parcours de ces jeunes. L’objectif sera d’étudier la variabilité des profils, afin de tenter d’identifier et de cerner des motivations communes. Pour cela nous nous appuierons sur une analyse à la fois qualitative et quantitative en s’intéressant à un corpus de jeunes concernés par ce phénomène . La possibilité d’intégrer une équipe de recherche, et de pouvoir consulter les dossiers de plus de trois cents condamnés pour terrorisme issus des archives du Parquet Antiterroriste de Paris , déjà accordée aux chercheurs du CESDIP, est un point important, qui s’intègre dans un travail d’enquête de terrain et d’entretiens . Il conviendra aussi d’étudier l’impact de la propagande sur internet. Il faudra, pour ce faire, procéder à un travail de recueil et de collecte systématique des éléments de propagande présents sur Internet en langue française et anglaise. Nous étudierons aussi la manière dont cette propagande est appréhendée par les autorités, tant en matière de prévention de la radicalisation qu’en matière de répression du terrorisme. Par ailleurs, nous étudierons comment le traitement juridique actuel du terrorisme place ces mineurs radicalisés au rang d’ennemis intérieur du pays . Nous analyserons le traitement pénal spécifique, dérogatoire, consacré aux mineurs radicalisés. Nous nous intéresserons aux vecteurs de déclenchement de la réponse pénale en matière de terrorisme, et à son contenu. Il conviendra de confronter la justice pénale des mineurs ordinaire à celle spécifique aux affaires qualifiées de « terroristes ». L’hypothèse d’un impact concret de la mise en œuvre du dispositif antiterroriste et de la soumission à la répression pénale sur la radicalisation de certains mineurs devra aussi être vérifiée. Il faudra aussi se demander dans quelle mesure les principes directeurs de la justice des mineurs – particulièrement les règles protectrices du mineur, y compris délinquant – sont préservés en matière de lutte contre le terrorisme . Il s’agira finalement d’analyser comment réagi notre système pénal, face à ce phénomène nouveau, tandis qu’apparait un régime dérogatoire répressif, suscitant des incompréhensions chez ces jeunes qui rentrent de Syrie, systématiquement incarcérés sans que soit prouvée leur éventuelle participations à des combats ou des attentats. En conclusion, le travail critique que nous proposons a pour objectif de mettre en évidence les lacunes et les limites d’un appareil répressif qui s’est construit dans l’urgence, en réponse à un phénomène nouveau qui a déstabilisé les populations comme les institutions. L’objectif de cette étude critique sera de proposer des solutions destinées à améliorer le traitement des mineurs radicalisés, tant au stade de la prévention des passages à l’acte violents qu’à celui de la répression, par la justice des mineurs, voire par de la justice antiterroriste. 28 mars 2022 – Thèse en science politique, de Alexis Provost L’accélération du temps pénal a déjà fait l’objet de plusieurs études en France qui se penchent sur l’apparition du Traitement en Temps Réel ou sur différentes procédures pénales accélérées. Mais rares sont les travaux qui cherchent à replacer cette dynamique dans un contexte européen. La comparaison avec l’Allemagne permet d’analyser comment des enjeux similaires, une volonté d’accélérer la justice et de la rendre plus efficace et rentable, peut mener à des évolutions très différentes. Ce travail vise, à travers des entretiens et la consultation d’archives, à retracer les innovations mises en place dans différents tribunaux et leur propagation éventuelle ainsi qu’à déterminer les interactions entre ces politiques pénales locales et celles engagées nationalement. 28 mars 2022 – Thèse en sociologie, de Alice Gaia. Alors que la plupart des recherches françaises en sciences sociales se sont longuement penchées sur l’entrée dans la délinquance et les facteurs de récidive, cette thèse s’intéresse aux sorties de délinquance – ou désistance. A partir des trajectoires d’anciens mineurs délinquants, ce travail – réalisé sous la co-direction de Philippe Robert (Cnrs-Cesdip) et Renée Zauberman (Cnrs-Cesdip) – a pour objectif d’étudier le désengagement des activités délictuelles en soulignant son caractère processuel. A partir d’entretiens de récits de vie menés auprès de personnes anciennement condamnées par une juridiction pour mineurs, il s’agit alors d’analyser les évènements de vie – tels que l’emploi, la vie maritale, etc. – survenus tout au long de leur parcours qui les ont conduites à changer ou à stopper leurs activités délinquantes. 7 janvier 2022 – Thèse en science politique, de Valérie Icard. À partir d’une comparaison entre la France et l’Espagne, cette thèse analyse les politiques contemporaines de réforme de la prison dans une démarche socio-ethnographique. À l’appui de monographies comparées de quatre établissements pénitentiaires, le processus de « normalisation carcérale » est étudié, dont l’objectif est de rapprocher la vie en détention de celle à l’extérieur. Trois modalités de normalisation retiennent l’attention : l’amélioration des conditions matérielles de détention, la transformation de la relation entre personnes détenues et personnel de surveillance (notamment via la sécurité dynamique) et l’autonomisation des personnes incarcérées (notamment promu dans les modules de respect, nouveau régime de détention). Nous proposons d’analyser la façon dont l’octroi de nouveaux droits aux personnes détenues et les objectifs de maintien de l’ordre s’articulent dans les réformes contemporaines de la prison. Plus précisément, l’objectif de cette thèse est de démontrer que le processus de normalisation constitue un levier de rationalisation de la gestion carcérale. L’enjeu analytique consiste à expliciter ce que l’on entend par cette notion de rationalisation, appliquée aux politiques carcérales contemporaines. Pour cela, la thèse s’organise autour de trois grands axes de questionnements. Nous proposons tout d’abord une sociologie politique des réformes de l’action publique carcérale dans deux cadres nationaux différents. Le regard se porte sur l’articulation entre les niveaux local et national (voire international) dans l’impulsion et la (non-)pérennisation des dispositifs affichés comme innovants. Ensuite, nous en observons les conséquences organisationnelles au sein des établissements. Plus spécifiquement, il s’agit d’analyser de manière comparée l’impact des politiques de normalisation sur l’évolution des pratiques professionnelles des surveillants, les ressorts de leur autorité et la relation qu’ils entretiennent avec les personnes détenues. Enfin, à partir de l’analyse de la différenciation des régimes de détention et des nouvelles stratégies d’activation et d’enrôlement des détenus, sont étudiées les reconfigurations des outils de production de l’ordre, de la discipline et du consentement à ceux-ci. Dans cette perspective, notre thèse propose une sociologie politique du maintien de l’ordre en prison, en analysant les nouvelles formes de pouvoir et de gouvernement des populations à l’œuvre dans l’institution carcérale contemporaine 30 mars 2021 – Thèse en science politique, de Valerian Benazeth. Comment les actions institutionnelles influencent-elles ou non la désistance, c’est-à-dire la lente, progressive et irrégulière sortie de carrière délinquante qui caractérise l’écrasante majorité des auteurs de comportements délinquants. Quels sont les leviers, les facteurs qui permettent de renforcer l’élan hors de la déviance ? Si des institutions comme la famille, le mariage, le travail, les relations vicinales sont connus pour avoir une influence, leurs effets précis et les moyens pour les mobiliser afin de susciter des sorties demeurent à identifier, déterminer et évaluer afin d’ajuster les actions publiques en conséquence et de produire des dispositifs innovants et plus efficients nourris par ces savoirs. Pour ce faire, l’étude d’une population de 16 à 25 ans exposée aux risques et tentations de l’investissement dans le trafic et la consommation de stupéfiants sur le territoire parisien a été privilégiée afin d’éprouver la validité des cadres théoriques de la désistance ainsi que dans l’espoir de produire des pistes nouvelles de recherche sous cet angle. 8 septembre 2020 – Thèse en science politique, de Manon Veaudor. Sous la direction de Jacques de Maillard et Christian Mouhanna. Cette thèse porte sur les pratiques d’affectation des détenus à l’intérieur des maisons d’arrêt. À partir d’une enquête ethnographique dans deux établissements pour hommes, elle interroge les modalités de production de l’ordre à l’appui de l’observation des pratiques des surveillant•es pénitentiaires, à travers les manières de classer, de catégoriser, d’affecter et de surveiller les détenus. L’analyse met également en regard les pratiques observées avec les points de vue des détenus. En combinant l’étude des modes d’identification de ces derniers avec celles des modes d’organisation des secteurs de détention, elle montre que la gestion de l’espace façonne également les « carrières » individuelles au sein de l’institution. Elle analyse pour cela les modalités de gestion de l’ordre carcéral en lien avec l’environnement extérieur, et notamment les territoires d’origine des détenus. Dans cette perspective, trois entrées sont privilégiées : l’une porte sur l’étude du quartier arrivants, l’autre sur les pratiques d’affectation telle que mises en place et perçues ; la troisième, enfin, s’intéresse à l’implantation du renseignement pénitentiaire. Ces points d’entrée permettent de saisir la façon dont les pratiques et les catégories pénitentiaires sélectionnent des informations sur l’environnement extérieur mais également sur les parcours antérieurs des détenus. On interrogera donc sous cet angle la reconfiguration des pratiques de surveillance à l’aune des réformes contemporaines de l’enfermement pénal. Le matériau mobilisé est issu d’une enquête de neuf mois dans deux maisons d’arrêt de régions différentes. Il combine l’observation des pratiques professionnelles en détention et au sein des commissions pluridisciplinaires d’affectation. Il se compose également d’entretiens semi-directifs menés auprès de détenus, de personnels de surveillance et de direction. Thèse en science politique : Thèse en science politique : Thèse en sociologie : Thèses en science politique : Thèse en sociologie : Thèse en science politique : Thèse en sociologie : Thèse en science politique : Thèses en science politique : Thèse en sociologie : Thèse en histoire : Thèse en histoire :